Après que Marin Ledun a ouvert le bal, Alec Covin continue avec l'analyse de Dracula de Bram Stroker. Je vous laisse donc avec cet auteur de talent.
Il ne se passe pas une année sans que je relise Dracula tant qu'à la longue, ce grand roman de Bram Stoker, écrit à la toute fin du XIXe siècle, m'est devenu ce qu'il me faut bien qualifier de livre de chevet, quoique je n'aime guère cette expression.
Une histoire de personnages
 Les grands personnages sont toujours nos amis. Nous aimons à les retrouver à intervalles réguliers, et bien que nous sachions déjà ce qu'ils vont nous dire, comme ces grands-parents qui racontent toujours la même vieille histoire mais qui la racontent si bien que nous ne sommes jamais sûrs que ce soit vraiment la même, nous sommes ravis de nous asseoir de nouveau à leur table, de sentir battre plus vite notre cœur en les écoutant une nouvelle fois encore.
Les grands personnages sont toujours nos amis. Nous aimons à les retrouver à intervalles réguliers, et bien que nous sachions déjà ce qu'ils vont nous dire, comme ces grands-parents qui racontent toujours la même vieille histoire mais qui la racontent si bien que nous ne sommes jamais sûrs que ce soit vraiment la même, nous sommes ravis de nous asseoir de nouveau à leur table, de sentir battre plus vite notre cœur en les écoutant une nouvelle fois encore.
Ainsi, pour moi, les personnages de Dracula : le pauvre Jonathan Harker, le Professeur Van Helsing, la douce Mina, mais aussi, et peut-être surtout, le vieux Comte roumain, à la fois si destructeur et si pathétique.
Inutile de rappeler ici le pedigree du personnage, ce ne serait que redites ennuyeuses. Et puis, d'ailleurs, le mythe se nourrit de fantasmes, de zones d'ombre, de méprises, bien plus que de ces réalités frappées du tampon officiel de l'Histoire. Tout ce qui est administratif lui est hostile, et le romancier authentique, ce mythographe des temps tout proches, est dans sa majesté un accoucheur de réalités nouvelles. Sous sa plume, tout le connu redevient une aventure, un risque, une terre à inventer. Il agrandit le monde, l'enrichit, il le presse d'être. Il n'en est pas le scribe besogneux, mais le perpétuel Christophe Colomb.
Ainsi ce bon vieux Bram Stoker, l'auteur de ce chef-d'œuvre. Un homme féru d'ésotérisme et de théâtre, c'est-à-dire de « mystères ». Un Anglais, naturellement, et d'origine irlandaise avec ça, puisque né à Dublin comme, d'ailleurs, Joseph Sheridan Le Fanu, l'auteur de Carmilla, et tout comme le célèbre Oscar Wilde, son cadet de sept ans, qui commettra le Portrait de Dorian Gray une couple d'années avant Dracula.
Rares sont les romans qui savent mettre en place un mythe si populaire et si vivace que, plus d'un siècle plus tard, il donne encore çà et là des rejetons. Le théâtre, d'abord, puis la radio et surtout le cinéma, ces arts de masse, s'en sont assez vite emparés, comme on le sait, participant à ce merveilleux bouturage, semant ici, repiquant là, greffant à tout va. Pourtant, je dois bien avouer que, contre toute attente, le cinéma n'entre que pour une faible part dans mon intérêt pour ce chef-d'œuvre victorien. Ni Bela Lugosi, ni Christopher Lee, ni, plus près de nous, Klaus Kinski ou plus récemment encore, Gary Oldman, qui, romantique jusqu'au bout des canines, campe le personnage du Comte dans l'ultime et flamboyante version donnée par F. F. Coppola, - aucune de ces incarnations de Dracula, disais-je, aussi brillante et originale soit-elle, ne me semble à la mesure de ce qu'il est réellement dans le roman de Stoker. Là résident le mystère et la force proprement pulsionnelle du mythe. L'essence de ce maître vampire déborde toutes ses existences contingentes, semblable en cela à Marilyn Monroe qui, comme chacun sait, n'a jamais existé.
Maintenant, si on tient absolument à savoir ce que représente pour moi le roman de Stoker, ce qu'il représente de particulier, je dirai volontiers qu'il forme à mes yeux l'un des quatre évangiles du fantastique anglo-saxon du XIXe siècle. J'ajouterai aussitôt qu'il ne faut cependant pas minorer la part d'humour qui entre dans ce texte. J'aime lire Dracula, oui, comme le récit, plein d'une ironie savoureuse, de deux voyages d'affaires qui tournent à la franche catastrophe : d'abord celui de Jonathan Harker, jeune solicitor frais émoulu venu rencontrer un client étranger dans son vieux château de Transylvanie ; enfin, et comme en réplique, celui, non moins désastreux, du client (à savoir, le comte) en Angleterre. Aucun des deux voyages ne se passe comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire, les autochtones ici et là n'étant visiblement pas très bien disposés à l'égard des intrus... En somme, Dracula c'est une apologie du rester-chez-soi, et qui procède par de saisissants contre-exemples.
aussitôt qu'il ne faut cependant pas minorer la part d'humour qui entre dans ce texte. J'aime lire Dracula, oui, comme le récit, plein d'une ironie savoureuse, de deux voyages d'affaires qui tournent à la franche catastrophe : d'abord celui de Jonathan Harker, jeune solicitor frais émoulu venu rencontrer un client étranger dans son vieux château de Transylvanie ; enfin, et comme en réplique, celui, non moins désastreux, du client (à savoir, le comte) en Angleterre. Aucun des deux voyages ne se passe comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire, les autochtones ici et là n'étant visiblement pas très bien disposés à l'égard des intrus... En somme, Dracula c'est une apologie du rester-chez-soi, et qui procède par de saisissants contre-exemples.
"C'est aussi, à mes yeux, un grand roman du « trans- » "
N'y est-il pas, en effet, question de transports, tumultueux et étranges, par mer ou par terre ? N'y est-il pas question de transactions concernant des propriétés à Londres ? N'y est-il pas encore question de « transfusions » (que ce soit par la bouche criminelle du vampire ou par les instruments salvateurs de la médecine) ? Et puis, surtout, n'y est-il pas question de transformations et de transgressions, Eros valsant ici avec un juvénile entrain aux bras de Thanatos ? Ce qui fait de Dracula un joyau de transgression dans un écrin 100% victorien, au même titre que cet autre chef-d'œuvre anglais, le Tour d'Ecrou du génial Henry James. Infanticides, décapitations, profanations de sépultures, résurrections diaboliques, orgies, telles sont quelques-unes des abominations que nous conte ce brave Stoker...
Circulation, donc, des corps, des biens et des marchandises (les cinquante caisses de terre consacrée sont l'emblème inoubliable du « trafic » interne à l'histoire), mais aussi circulation des mots, communication tous azimuts, le roman dans son entier se composant de lettres, de télégrammes, d'extraits de presse ou bien encore, et pour une large part, de journaux intimes.
L'étonnant dans Dracula est que le seul qui n'écrive jamais « Je » est justement le vampire, le point focal des préoccupations des autres « Je » qui le circonscrivent de proche en proche, le décrivent, le définissent, avant de l'assaillir et de réussir à le détruire. Il faudra attendre la louisianaise Ann Rice pour que les vampires aient enfin le droit de tenir leur propre journal, acquérant par là subjectivité et sentiments. Avec elle, les suceurs de sang s'humanisent pour de bon, ils ne sont plus d'irréductibles étrangers bons qu'à semer l'effroi parmi nous et incapables de partager nos émotions. Si Je est un autre, pour reprendre la célèbre formule de Rimbaud, le Je de Dracula est un autre si radical, un étranger si définitif qu'on ne peut, aux yeux de Stoker, que le combattre et le nier. Il est l'ennemi absolu, qui n'a pas droit au Je de la persona civilisée ; il est cela qui apporte la malemort dans la cité, tels les rats d'une épave la peste ; il est la Mort qui ne meurt pas, cette force archaïque, sauvage, que les religions et les sociétés « civilisées » (ici, l'empire britannique avec ses médecins et ses hommes de loi) n'ont cessé de vouloir « encadrer » à défaut de pouvoir la conjurer.
Grand roman de la communication, plus que d'une intersubjectivité réellement assumée, Dracula fait entendre la musique bien accordée de toute une série de « Je » plutôt que la cacophonie toujours possible de leurs « moi », c'est une partition où l'intime est toujours dicible, policé, utile à l'action, où les journaux sont d'ailleurs si peu intimes que les personnages qui les écrivent les donnent à lire aux autres sans aucune espèce de réticence. Ici, toutes les voix concordent, tout coïncide et converge. Pas d'incertitude ni de contradictions, pas de ratures ni de méprises. Le « Je » textuel n'est jamais un « moi » existentiel véritable, investi d'une dimension psychologique forte. Stoker n'est pas Conrad. Tous deux vénéraient Shakespeare ; à l'évidence, pas pour les mêmes raisons.
Cette psychologie sommaire constitue, je le sais bien, le ventre mou de Dracula, et on serait en droit de tenir ce roman pour mineur si on oubliait un instant (mais est-ce possible ?) qu'il s'agit avant tout d'un récit d'aventures, où seule prime l'action. Et puis, ce roman, par bien des aspects, s'apparente à un conte et c'est heureux, me semble-t-il, car il ne peut y avoir de bon fantastique sans l'établissement d'un lien puissant, justement, avec l'univers archaïque des contes. Cet univers se manifeste surtout dans la première partie, celle qui relate le voyage de Jonathan Harker dans les Carpates et son terrifiant séjour au château. Rappelons l'interdit prononcé par 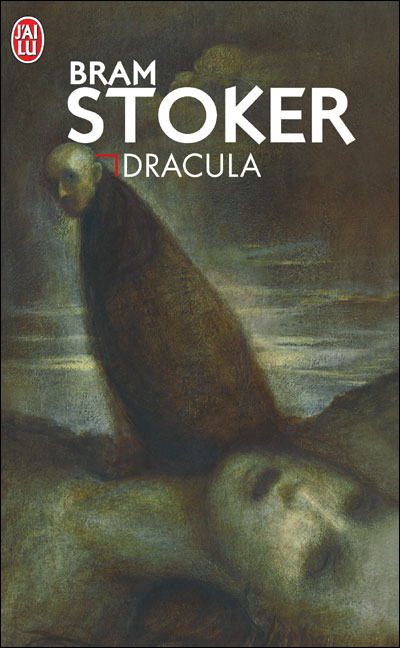 Dracula : « Vous pouvez aller partout où vous voulez dans le château, excepté dans les pièces dont vous trouverez les portes fermées à clef, et où naturellement, vous ne désirerez pas entrer. Il y a une raison à ce que toutes les choses soient comme elles sont, et si vous les voyiez comme je les vois, si vous saviez également ce que je sais, peut-être comprendriez-vous mieux. » (trad. Lucienne Molitor, Bouquins, Robert Laffont) Barbe-Bleue, on le voit, n'est pas loin. Nous sommes en plein conte. C'est une évidence, aussi, que les tabous, dans ce genre d'histoire, ne sont édictés que pour être transgressés, et celui posé par Dracula, bien sûr, ne fait pas exception à la règle. Comme il fallait s'y attendre, Jonathan désobéit au Comte, et, comme il fallait le craindre, il se retrouve aussitôt dans une situation des plus périlleuses où la signification de l'Interdit se révèle ouvertement érotique puisque notre jeune Anglais doit affronter trois créatures aux appétits très développés. Je note, en passant, la récurrence symptomatique du chiffre 3. Au château les femmes vampires sont au nombre de trois et elles apparaissent trois fois dans le roman. Quant au Comte, il demande à Jonathan d'écrire trois lettres, toutes postdatées et dont la date de la troisième fait présumer au jeune homme celle de sa mort prochaine. Ce qui n'est pas sans rappeler le lien symbolique ancien existant avec Atropos, la troisième des Parques.
Dracula : « Vous pouvez aller partout où vous voulez dans le château, excepté dans les pièces dont vous trouverez les portes fermées à clef, et où naturellement, vous ne désirerez pas entrer. Il y a une raison à ce que toutes les choses soient comme elles sont, et si vous les voyiez comme je les vois, si vous saviez également ce que je sais, peut-être comprendriez-vous mieux. » (trad. Lucienne Molitor, Bouquins, Robert Laffont) Barbe-Bleue, on le voit, n'est pas loin. Nous sommes en plein conte. C'est une évidence, aussi, que les tabous, dans ce genre d'histoire, ne sont édictés que pour être transgressés, et celui posé par Dracula, bien sûr, ne fait pas exception à la règle. Comme il fallait s'y attendre, Jonathan désobéit au Comte, et, comme il fallait le craindre, il se retrouve aussitôt dans une situation des plus périlleuses où la signification de l'Interdit se révèle ouvertement érotique puisque notre jeune Anglais doit affronter trois créatures aux appétits très développés. Je note, en passant, la récurrence symptomatique du chiffre 3. Au château les femmes vampires sont au nombre de trois et elles apparaissent trois fois dans le roman. Quant au Comte, il demande à Jonathan d'écrire trois lettres, toutes postdatées et dont la date de la troisième fait présumer au jeune homme celle de sa mort prochaine. Ce qui n'est pas sans rappeler le lien symbolique ancien existant avec Atropos, la troisième des Parques.
Des fils aux pères
Des contes à la psychanalyse, il n'y a qu'un pas, ici vite franchi. Je veux dire par là qu'on peut faire une lecture freudienne du livre, que c'est même recommandé. Pour ma part, j'ai tendance à y voir une traduction fantastique du conflit qui aurait opposé la horde primitive au clan fraternel, tel que Freud devait l'élaborer quelques années plus tard dans Totem et tabou en prenant appui sur les recherches de Darwin et, surtout, de Robertson Smith, deux grands esprits contemporains de Stoker.
On sait selon cette théorie que le conflit qui oppose le père de la horde à ses fils rebellés a pour motif principal la possession des femmes. Ici, c'est d'abord Lucy, puis Mina, les seules jeunes femmes de l'histoire et qui sont toutes deux en situation de se marier, comme par hasard. Coppola, dans son adaptation du roman, a accentué cet aspect sexuel en rendant le Comte amoureux de Mina (ce qu'il n'est pas dans le roman, contrairement à ce que disent certains critiques étourdis !) et en faisant de cette dernière la réincarnation de son ancienne épouse, ceci n'ajoutant pas grand-chose à cela, me semble-t-il.
Dans le scénario freudien, le conflit aboutit au meurtre du père tyrannique par les fils coalisés, qui mettent ainsi fin à l'ancienne sauvagerie. Meurtre et fin essentiellement dialectiques puisqu'ils ne signifient en aucune façon disparition complète de l'ordre paternel, tabula rasa, mais bien plutôt Aufhebung au sens hégélien du mot. Les fils, pris de remords, décident en effet de perpétuer la mémoire du Père, un peu comme s'ils n'avaient jamais osé le mettre à mort. Dans Dracula, l'Aufhebung est évidemment fantastique, c'est-à-dire à rebours. Le père primitif est déjà un non-mort ; et sa disparition violente permet non pas l'avènement mais l'auto-conservation de la société nouvelle (en l'occurrence, capitaliste) établie par les fils.
société nouvelle (en l'occurrence, capitaliste) établie par les fils.
Les dernières lignes du texte sont ouvertement « totémiques », si je puis dire, puisqu'elles proposent justement la commémoration du meurtre du père par les fils coalisés, ce qui est la fonction première du totem.
Tout comme les frères du clan sont devenus pères à leur tour, Jonathan, nous apprend-on, a engendré un garçon (le père est mort, vive le père !) et il est significatif que cet enfant porte le prénom d'un mort (Quincey, l'aventurier américain) en mémoire du grand combat qu'ils ont mené ensemble contre Dracula.
Ecoutons donc parler Jonathan Harker : « Notre fils est né au jour anniversaire de la mort de Quincey Morris, joie de plus pour Mina et moi. Elle garde, je le sais, la secrète conviction que quelque chose de l'esprit de notre héroïque ami a passé en notre enfant. Nous lui avons donné les noms de ceux de notre petit groupe, mais c'est Quincey que nous l'appelons. » (C'est moi qui souligne.) Rappelons que Quincey est l'un des deux meurtriers de Dracula et qu'il a trouvé la mort dans cette action formidable. Se souvenir de sa fin, c'est donc rappeler ipso facto celle de Dracula, l'une n'allant pas sans l'autre.
De plus, si nous voulons bien accepter avec Freud que l'œuvre littéraire, comme le rêve ou le fantasme, procède souvent par substitutions, déplacements ou bien encore travestissements, alors nous pouvons remplacer « Quincey » par « Dracula » dans les propos de Jonathan que nous venons de citer, et ainsi nous verrons se dresser devant nous un prodigieux totem aux dents blanches et pointues et aux yeux écarlates de sang.
Malheureusement, nous ne pouvons, faute de temps, pousser plus avant cette idée du totémisme qui nous paraît pourtant cruciale pour la compréhension de Dracula, mais précisons ici encore deux ou trois choses.
Les « fils » héroïques sont, il va sans dire, mais comment pourrait-il en être autrement sous la plume d'un Stoker, tous anglo-saxons : anglais pour la plupart, à l'exception de Quincey Morris, qui est citoyen américain. Les « pères » symboliques, eux, sont d'origine étrangère : Dracula, archétype du mauvais père, est roumain ; et le professeur Van Helsing, le bon père, hollandais. Imagos paternelles tous deux, le comte et le professeur ont d'autres points communs, qui instaurent entre eux moins une ressemblance véritable qu'une symétrie quasi parfaite.
D'abord, tous deux ont un rapport au savoir et aux livres. A la bibliothèque de Dracula sur Londres et ses habitants correspondent les livres de Van Helsing sur le nosferatu et ses mœurs. Leurs centres d'intérêt, on le voit, sont complémentaires.
Tous deux ont aussi un lien avec le sang, par la succion vampirique pour le Comte, par la transfusion médicale pour le Professeur, et tous deux ont à voir avec les femmes et la mort. Dracula fait sienne Lucy et c'est Van Helsing qui convainc ses amis de la décapiter pour la délivrer. Puis quand Dracula s'en prend à Mina, c'est Van Helsing qui est chargé de la garder. Enfin, c'est au Professeur que revient, à la fin, la mission de liquider les trois femmes vampires. « N'était-ce pas la tâche d'un boucher ? » se demandera-t-il après avoir enfoncé un pieu dans chacune des non-mortes surprises dans leurs sépulcres et leur avoir tranché la tête selon les règles. Van Helsing, question boucherie, fait la pige à Dracula lui-même !
Ajoutons, et nous en resterons là, que l'un et l'autre sont doués d'un caractère pour le moins bien trempé.
Dracula a la fierté ombrageuse d'un vieux boyard plus rusé qu'un Machiavel. Van Helsing, lui, est un esprit fantasque, exubérant jusqu'à sembler brutal sinon barbare, quelque peu morbide aussi, et, au final, il peut apparaître à nos yeux plus inquiétant que le vieux Comte des Carpates. Psychologiquement, ce sont de loin les personnages les plus réussis, tant et si bien qu'on est en droit de se demander si Dracula n'est pas, malgré tout, un roman du Père bien plus qu'un roman des Fils, un récit de la Tradition plutôt qu'un récit de la Modernité...
Tous droits de copie réservés à L'Art de lire et Alec Covin

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire